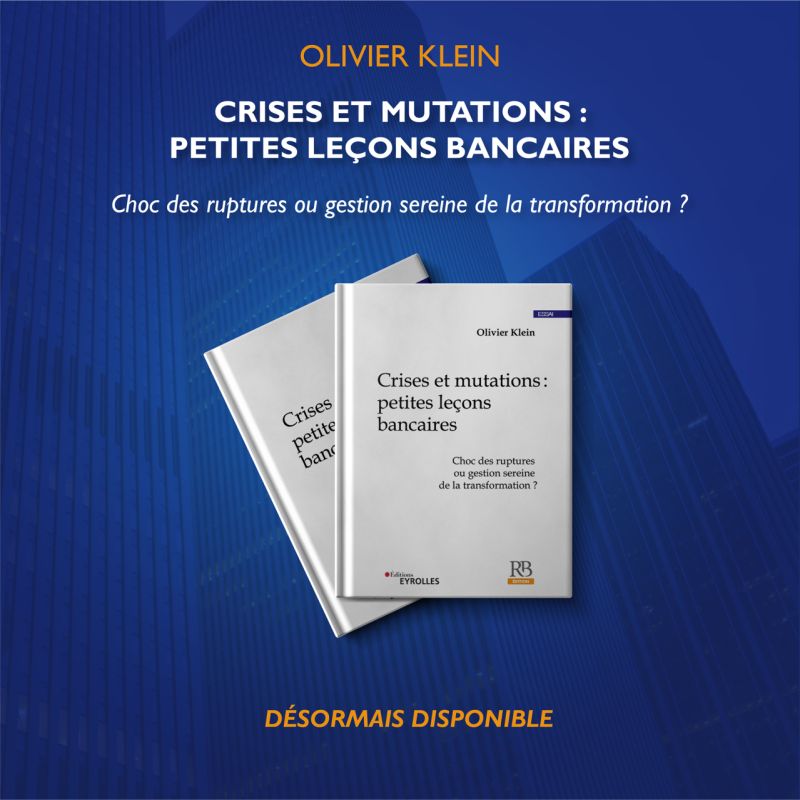Ce professeur d’économie a transformé la BRED, qu’il a dirigée pendant plus de dix ans.
Il arrive légèrement essoufflé, s’excusant de son retard dans un grand sourire. Élégant dans son costume sombre et sa cravate en soie bleu ciel, Olivier Klein, le directeur général de la BRED, invite à entrer dans son bureau contemporain dominant la Seine et peuplé de statues africaines dont il fait la collection. Mais la vraie passion de cet amateur des arts premiers est la banque, et en particulier la sienne, qu’il dirige de main de maître depuis plus de dix ans, avec succès puisque le produit net bancaire a augmenté de 70% en une décennie. Ce patron est également professeur à HEC et auteur de nombreuses publications. Une vie bien remplie, « un accomplissement », dit-il, dont il est fier. Il peut ainsi passer des heures à parler des marchés mondiaux, multipliant les traits d’humour et usant de pédagogie pour décoder un monde complexe fermé aux profanes.
Pourtant, à 65 ans, après un parcours exemplaire à la tête de grands établissements, il a dû quitter la BRED, à la fin mai. Lorsqu’il évoque ce départ imminent, en ce jour d’avril, les yeux de cet homme au caractère joyeux se voilent. « Ce n’est pas facile de partir », avoue-t-il sans détour. Ayant atteint la limite d’âge, il a laissé à regret son poste. Un petit moment d’abandon vite oublié lorsqu’il se met à raconter son épopée bancaire, commencée au début des années 1980.
Spécialiste des fusions-acquisitions
L’économie, rien que l’économie. Lorsqu’Olivier Klein sort diplômé de l’École nationale de la statistique et de l’administration (ENSAE), du cycle d’études supérieures d’HEC et d’une licence à l’université Panthéon-Sorbonne, il hésite. Va-t-il devenir un économiste distingué, plongé dans les études et les prévisions? Tentant, mais le jeune homme préfère finalement la banque, située « au carrefour de l’économie ». Il se souvient : « J’avais besoin d’agir, de réaliser des choses concrètes ». En 1985, il intègre donc la Banque française du commerce exté- rieur (BFCE), devient directeur du département de conseil en gestion de risque de change et de risque de taux d’intérêt et construit des offres complexes pour les grands groupes. Puis il crée la banque d’affaires de la BFCE, qu’il dirige. Ce métier le comble. Mais cela ne suffit pas à son bonheur. Alors, pour continuer à plancher sur la macroéconomie et satisfaire sa grande curiosité, il devient professeur affilié à HEC : « Je ne joue pas au golf, je n’ai pas de hobby, mais j’ai besoin de réfléchir et de transmettre; cela me permet d’être un meilleur banquier », plaide- t-il, affirmant qu’il a su prévoir la crise financière de 2008, grâce à une veille permanente, à l’appréhension globale du système et à un regard toujourscritique. « Constammentàl’écoutedes signaux faibles du marché, c’est un visionnaire ; il sait anticiper puis décliner sa stratégie », observe Françoise Epifanie, directrice du développement de la BRED. Une double vie qui le rend atypique dans l’univers de la banque : « Il est à la fois un intellectuel, professeur d’économie, et un opérationnel très précis : un équilibre très rare ! », confie Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts. Accrocheur, bosseur – « Il a une capacité de travail hors‐norme », dixit un cadre dirigeant –, il n’a jamais lâché le professorat. Même lorsqu’il intègre le groupe Caisse d’Epargne, en 1998, où il est d’abord nommé président du directoire de la Caisse d’Epargne Île-de-France Ouest avant d’être dépêché à Lyon. Pource Parisien depuis quatre générations, c’est le premier job hors de la capitale. Mais ce gourmand, amateur de bons vins, adore l’endroit et « prend conscience du fait régional français », affirme-t-il. Olivier Klein réalise que c’est la forte implication des directeurs d’établissement partout en province qui explique le succès des banques de détail. Spécialiste des fusions-acquisitions, il est chargé de marier la Caisse d’Epargne des Alpes et celle de Rhône-Alpes Lyon. Un prélude aux futurs rapprochements, comme celui des Banques Populaires avec les Caisses d’Epargne en 2008 (devenu la BPCE), auquel il a activement participé.
Directeur général en charge de la banque commerciale et des assurances au sein du groupe nouvellement constitué, Olivier Klein lorgne très vite sur la BRED –dont il a fait « un petit bijou », admire Edmond Alphandéry, ancien ministre de l’Économie, qui fut son professeur. Profitant du départ à la retraite de son prédécesseur, il prend sa tête en 2012. C’est une banque entrepreneuriale, « la plus complète du groupe BPCE », se réjouit-il. Il la développe à marche forcée, à contre-courant de l’ensemble du secteur bancaire, pressé de privilégier le digital au détriment des établissements physiques. Lui, au contraire, maintient les agences en place, en ouvre d’autres et augmente le nombre d’employés. Sûr de sa stratégie, il lance le concept de « banque sans distance », par opposition aux pure players (à distance) et augmente son budget formation de 40%, afin de permettre à ses salariés d’accompagner au mieux leurs clients dans leurs projets de vie. « Il a compris que la réussite d’une entreprise passait par la qualité de ses équipes », souligne un proche. Lui veut faire de la BRED une banque 100% conseil, au grand dam de son équipe, qui le trouve un peu trop audacieux et pressé.
Perfectionniste
Pourtant, la crise du Covid-19 lui donne raison et accélère la transformation. L’ambitieux décide également de conquérir de nouveaux marchés et accélère au Cambodge et aux îles Fidji : « Il s’est installé dans des endroits où les banquiers ne vont généralement pas, et il a eu raison », constate Edmond Alphandéry. Sans fausse modestie, Olivier Klein se réjouit lui aussi de ses résultats, qu’il envoie à tous ses proches! Son goût pour la haute stratégie ne l’empêche pas de suivre quotidiennement la vie de l’entreprise. Il fait souvent le tour des agences en régions et commence toujours ses visites par la vérification des guichets automatiques. Homme de communication – et de discours –, il apprécie ces tournées au cours desquelles il échange avec ses salariés, les rassure et les mobilise. En revanche, ce perfectionniste ne supporte pas l’à-peu-près. « Il ne lâche rien, il est sur tous les fronts, quelle que soit l’activité », reconnaît Françoise Epifanie, qui plaisante : « C’est un peu Monsieur Plus. » Et s’il sait déléguer lorsqu’il a confiance, le patron bienveillant garde toujours un œil sur tout. Même en vacances, il a du mal à décrocher.
À l’approche de son départ, le sexagénaire se sent en pleine forme. Il a beau adorer sa collection de statues africaines comme celles de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui trônent chez lui dans une pièce dédiée, Olivier Klein est prêt à repartir vers de nouvelles aventures.
L’Hémicycle – Corinne Scemama
Article publié le 19 juin 2023.
Dates clés
- 15 juin 1957 : Naissance à Paris.
- 1985 : Directeur du département de conseil en gestion de risque de change et de risque de taux d’intérêt des grands clients de la Banque française du commerce extérieur (BFCE), puis de la banque d’affaires qu’il crée au sein du groupe.
- 1985 : Professeur affilié à HEC.
- 1998 : Président du directoire de la Caisse d’Epargne Île-de-France Ouest, puis de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes Lyon.
- 2010 : Directeur général du groupe BPCE, en charge de la banque commerciale et des assurances.
- 2012 : Directeur général de la BRED.